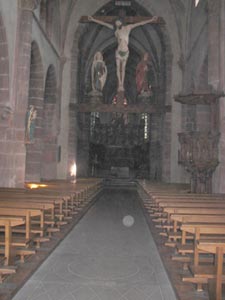|
|
L'église Sainte-Croix
Trésor pour les yeux et pour l'esprit |
|
 L'église et la chapelle Saint-Wolfgang au
fond.
L'église et la chapelle Saint-Wolfgang au
fond. |
Kaysersberg situé au pied de son château ruiné
jouissait dès la fin du Xlll siècle d'importants droits
et privilèges, faisant partie de la Décapole de la
ligue des dix villes impériales d'Alsace.
Le grand nombre de belles maisons et les trésors artistiques
de son église sont la meilleure preuve du grand développement
des XV et XVI siècles
|
|
 |
Peu après la fondation de la ville par les Hohenstaufen,
on commença à ériger l'église dédiée
à la Sainte-Croix (1227) dont elle possédait probablement
déjà une relique. Une statue (moderne) de l'Impératrice
Hélène dans une niche du fronton de l'église
et celle de l'Empereur Constantin, son fils, sur la belle fontaine
devant le sanctuaire rappellent la tradition suivant laquelle l'Impératrice
Hélène aurait découvert la vraie croix en 327
à Jérusalem. |
 |
|
| Deux conceptions architecturales |
|
L'église de Kaysersberg tire son charme et son intérêt
de la rencontre de deux conceptions architecturales différentes.
Elle fut conçue dans un esprit roman influencé
par l'idée gothique pénétrant de plus
en plus en Alsace.
Le portait ouest avec ses arcs en plein-cintre, ses rangées
de colonnes à chapiteaux enjolivés de palmes
et de sirènes est une copie manifeste des portails
romans d'églises alsaciennes.
Au contraire dans la nef, la lourdeur des formes périmées
doit céder la place à la nouvelle légèreté
et l'élégance fonctionnelle du gothique naissant.
A l'intérieur du sanctuaire la tension entre les deux
styles se retrouve également. La profonde impression
que le visiteur en emporte est due aux piliers massifs et
à la hauteur de la nef principale.
|
|
 |
|

Colonnes à chapiteaux du portail
|
|
|
|
 |
L'église est longue de 29 m et sa hauteur à la clef
de voûte est de 12,35 m. Le transept et le choeur surélevé
abritent une crypte hexagonale dont les nervures de la voûte
sont interceptées par une colonne centrale. Au-dessus de
l'intersection de la nef s'élève sur des piliers massifs
un beffroi haut de 41 m. Sa forme actuelle remonte à 1827
où les Kaysersbergeois voulaient avoir une sonnerie de 5
cloches. A ce moment le clocher fut transformé et rehaussé,
sa flèche primitive remplacée par une calotte aplatie
L'abside triangulaire et la travée du choeur, remontent au
XVe siècle. A cette époque, le sanctuaire étant
devenu trop exigu, les travaux d'élargissement des bas-côtés
commencèrent le 20 juillet 1448, en la fête de Sainte
Marguerite. Une inscription sur la façade sud indique le
jour, de l'ouverture des travaux.
Les nefs latérales montrent de belles voûtes, gothiques
dont les clefs de voûte sont ornées d'écussons.
Sérieusement endommagée pendant la dernière
guerre mondiale (hiver 1944-1945), l'église a été
restaurée d'une façon parfaite.
|
|
| "Le Christ Colossal" |
|
La nef centrale est dominée par un calvaire monumental.
Cette œuvre nommée "Christ Colossal"
date de la fin du XVe siècle et le corps allongé
et svelte du Christ en bois de tilleul d'une hauteur de 4,25
m est disproportionné par rapport à celui de
la Sainte Mère et du Disciple bien aimé, Saint
Jean, mesurent quant à eux 2,60 m.
Au milieu du XVIII sjècle (vers 1766), le magistrat
en fonction considéra que ce calvaire "masquait
et défigurait toute l'église"...
Il le fit donc descendre et le relégua a la chapelle
St-Michel située derrière l'église.
Et ce n'est qu'en 1905 que cette œuvre fut remise à
sa place, place qu'elle occupe encore aujourd'hui!
|
|
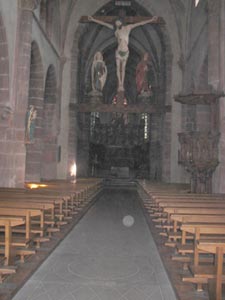 |
|
|
|
 Détail du retable
Détail du retable |
|
Ce qui frappe également à
l'intérieur du sanctuaire est l'importance et la richesse des
œuvres d'art datant principalement du premier quart du XVI siècle.
L'imposant autel de la passion qui domine le chœur est l'œuvre
de Jean Bongratz, de Colmar, et a été réalisé
en 1518. Autour d'un panneau central qui représente une crucifixion
déjà achevée, quatorze reliefs dorés et
polychromes relatent la passion du Christ depuis son entrée
à Jérusalem jusqu'à sa Résurrection.
Le retable est couronné de saint Christophe de l'impératrice
Hélène et de sainte Marguerite. Sur le revers du retable,
des tableaux de Matthias Wuest de 1622 racontent l'histoire de la
découverte et de l'exaltation de la croix.
Précisons que sur la maison Foltz située dans la Grand-rue
à Kaysersberg, le même artiste a peint des fresques beaucoup
plus révélatrices de ses talents. |
|
| L'art et la
prière |
|
Dans le bas-côté nord, au-dessus des fonts baptismaux
gothiques de 1448, Saint-Jean est bien à sa place car
il fut le premier à baptiser. En face, dans le genre
des anciennes statues de pèlerinage, Jacques le Majeur.
Nombreux furent les pèlerins qui l'ont salué
depuis qu'il fut sculpté en 1523 pour notre église
située sur la grande route des pèlerins entre
l'Allemagne et Saint-Jacques de Compostelle.
Dans le bas côté gauche, le Saint Sépulcre
est l'oeuvre de deux sculpteurs différents. Tandis
que le Christ remonte à l'époque du gothique
tardif (1448), les saintes femmes (1514) annoncent la Renaissance.
Le relief de la Déploration, œuvre la plus précieuse
de l'église de Kaysersberg, a repris tout son éclat
grâce à une excellente rénovation entre
1956-1957.
Pour les uns cette œuvre date de 1500 et pour les autres,
dont Hans Rott, elle date de 1521 et est l'oeuvre du maître
Georges Berringer, de Lucerne...
En comparant la même scène au retable on peut
discerner l'inégalité de perfection. Dans le
premier cas, le groupement des personnes est laissé
au hasard tandis que sur le relief de la Déploration,
chaque ligne, chaque pli de robe et chaque regard sont chargés
d'expression. L'artiste a eu le constant souci d'exprimer
la douleur sous toutes ses nuances. Le visage couvert de larmes
de Madeleine, sa chevelure défaite, l'incurvation expressive
de son corps se résument en un seul et même cri.
Tous les ans, des milliers de visiteurs franchissent le portail
de notre église. L'importance et la richesse des œuvres
d'art n'ôtent rien à la profonde sérénité,
que l'on' peut y trouver et qui invite au recueillement et
à la prière.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Une horloge
dès 1511 |
Les archives municipales nous permettent de constater que
le premier document mentionnant l'existence d'une horloge, date
de 1511, année où le magistrat avait chargé
maître Goerg, serrurier à Colmar, d'installer une
grande horloge.
Tout au début du XVII siècle, c'est un horloger
de Brisach qui fut chargé de l'entretien annuel du mécanisme.
Puis, tout au long du XVII et du XVIII siècle, les délibérations
du conseil font état des réparations et de l'entretien
de l'horloge dont le mécanisme avait été
transporté à Colmar en 1785 pour y être
révisé.
Le 26 avril 1835, la ville approuva un devis pour la mise en
place de trois nouveaux cadrans.
A la fin de l'année 1865, Urbain Adam, horloger mécanicien
à Colmar, fut chargé d'installer une nouvelle
horloge à Kaysersberg, dont la réception eut lieu
le 20 février 1867... avec une garantie de 15 ans.
Après les dernières hostilités, la ville
chargea la maison Ungerer de Strasbourg de procède à
une révision complète des mécanismes de
l'horloge. Les travaux s'échelonnèrent de 1949
à 1950. Il fallut remplacer les cadrans et installer
un remontage électrique automatique.
Actuellement, la nouvelle horloge de l'église paroissiale
est réglée par micro-ordinateur et reliée
directement à l'horloge de l'observatoire de Strasbourg.
|
|
|
|
|